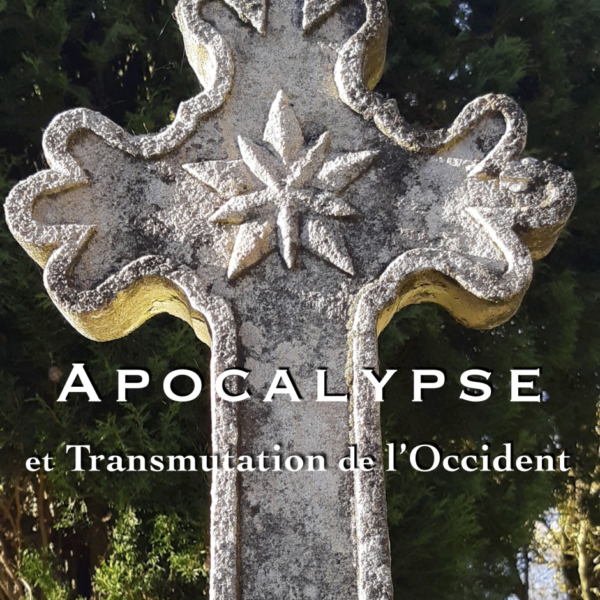Voici comment Raymond Abellio a présenté, dans Sol Invictus (1980), son incomparable dialectique de l’Occident et du « peuple élu ». Je n’y ai ajouté que quelques mentions entre crochets.
« Dès que commence réellement notre cycle d’histoire, c’est-à-dire vers ce VIe siècle avant l’ère chrétienne qui marque l’apparition initiatique, dans le monde hellénique, des valeurs proprement civilisatrices, d’ordre strictement social, qui vont former l’esprit d’Occident, le peuple juif, déporté au même moment à Babylone, se trouve pour sa part et comme par symbole arraché de son sol et déraciné. C’est au moment où la civilisation dite occidentale, dans ses principaux caractères, se forme dans le creuset de la cité grecque, qui va même lui donner son nom (puisque civis signifie ’’citoyen’’, membre de la cité) que le peuple juif est au contraire expulsé de sa ville, Jérusalem, et que ses propres valeurs, au lieu de s’étendre comme vont le faire celles de l’Occident grec, connaissent d’abord le confinement et la compression de l’exil. Il y a dès ce moment un étrange et significatif parallélisme inverse entre la généalogie de l’Occident et le destin du peuple juif. Et même l’emploi contrasté de ces deux mots de ’’généalogie’’ et de ’’destin’’ contient ici un sens profond. L’Occident va connaître durant vingt-cinq siècles un commencement, une évolution-involution et une fin où se marquent, par l’affrontement dialectique de plus en plus rude de sa matière et de son esprit, les changements incessants que subit son essence elles-même. On peut parler à son sujet d’une sorte de création continue, de permanente genèse. Rien de tel pour le peuple juif dont l’essence paraît, dès l’origine, fixée pour l’éternité, et que les pires accidents de l’histoire ne semblent pas atteindre dans son être inaltérable. L’impérialisme des Occidentaux agit sans cesse par l’occupation, la colonisation brutale, extensive puis intensive, de l’espace. Tout au contraire, l’universalisme juif reste en apparence passif : ses expansions ne suivent pas la marche de ses conquêtes mais de ses exils, elles ne résultent pas d’une colonisation victorieuse mais d’une diaspora, d’une dispersion forcée, et l’on ne saurait en fin de compte les dire ’’explosives’’ comme celles de l’Occident mais ’’implosives’’, car chaque fois elles résultent d’un coup frappé au dedans et non au-dehors. Dans mon ouvrage sur la ’’structure absolue’’ j’ai dégagé les quatre étapes de toute genèse : conception, naissance, baptême et communion, ces deux derniers mots employés dans un sens ontologique plus intégrant que leur acception religieuse. Lors de la conception, l’embryon se forme de façon invisible à tous les yeux ; la naissance est au contraire mise au monde, apparition d’un être qui est vu mais ne se voit pas, et n’est ainsi en lui-même qu’un objet dans un monde d’objets ; le baptême est au contraire le moment où cet être se voit pour la première fois en tant que sujet mais toujours dans un monde d’objets et se veut ainsi distinct et autonome, créateur de ses propres valeurs ; la communion, enfin, le moment où ce même être, accédant à l’intersubjectivité, voit ce monde d’objets comme un monde de sujets et où commence la communication, l’universalisation de ces mêmes valeurs. Il est remarquable que cette division, si on l’applique aux vingt-cinq siècles de l’histoire de l’Occident, permette de situer les quatre âges ’’progressistes’’ de celle-ci exactement aux mêmes dates que les grandes crises du destin des Juifs, quatre rencontres que cette concordance réitérée semble ainsi transformer, dans l’histoire invisible, en véritables rendez-vous. Avant de revenir en détail sur chacune d’elle, j’énumère ces quatre étapes où, chaque fois, le destin du peuple juif est mis en rigoureuse inversion par rapport à celui de l’Occident : la ’’conception’’ d’abord qui a lieu, je viens de le dire, au VIe siècle avant notre ère, à l’aurore de la philosophie rationaliste, par l’explosion du génie grec, mais qui est aussi l’époque, pour les Juifs, de cette captivité de Babylone où se codifie définitivement leur loi [et leur gnose issue d’Egypte…] ; la ’’naissance’’ ensuite, avec la christianisation de l’Empire romain qui voit aussi la destruction du Temple de Jérusalem, l’épouvantable répression décrite par Tacite, la grande diaspora ; le ’’baptême’’ au début des temps modernes, lorsque l’Europe, dont la frontière orientale est maintenant fixée [par les Turcs à Byzance en 1453], s’ouvre à l’ouest par ses grandes navigations océaniques, mais la date de 1492 qui voit la découverte de l’Amérique et marque, comme il convient à tout baptême, le début d’une période très justement nommée ’’Renaissance’’, est aussi celle de l’expulsion des Juifs d’Espagne et de leur départ pour un nouvel exil, moment capital de part et d’autre pour une double prise de conscience, et où tout se passe comme si, en s’ouvrant victorieusement à l’Ouest, l’Occident préparait aux Juifs, pour un nouvel Exode, la nouvelle terre promise, le nouveau Canaan prédestiné que sera bientôt leur base américaine ; la ’’communion’’ enfin, qui commence à la fin du XVIIIe siècle, par la guerre d’Indépendance en Amérique et la Révolution française de 1789, proclamant ensemble les nouveaux droits de l’homme, tout en procédant, et là aussi la rencontre est pleine de sens, à l’immédiate reconnaissance de la citoyenneté des Juifs. Ici le caractère inverti du destin des Juifs n’apparaît plus, mais c’est que l’inversion devient le fait général de la civilisation occidentale elle-même, adoptant, érigeant et profanant à son tour en valeurs politiques les valeurs religieuses de liberté, d’égalité et de justice, et préparant ainsi la catastrophe finale de l’Occident tout entier.
J’appelle ’’histoire invisible’’ celle qui, par la considération des causes finales mais aussi l’insertion et le dépassement de celles-ci dans une gnose ’’absolue’’, met en rapport sous une même date, par exemple 1492, des faits entre lesquels l’histoire visible, selon toute apparence, ne sait reconnaître aucun lien. En établissant des corrélations entre deux séries de faits apparemment indépendants, l’histoire ainsi ’’structurée’’ s’enrichit de significations qu’il me faut bien appeler une fois encore métaphysiques ou métapolitiques puisque la physique sociale usuelle les méconnaît. »
« Et c’est parce que la généalogie de l’Occident d’une part, le destin du peuple juif de l’autre, sont pris ensemble dans cette structure comme l’avers et le revers d’une seule réalité que cette histoire commune transcende non seulement l’histoire des événements séparés mais les conduit surtout l’une comme l’autre à sortir de l’histoire.
C’est donc au VIe siècle avant notre ère, au temps de Pythagore et de Thalès, que l’Occident commença à forger, en Grèce, les valeurs civilisatrices d’une philosophie et d’une science qui allaient lui permettre, par leur efficacité, de prétendre à l’empire du monde, dans le même temps que le peuple juif, déporté à Babylone, perdait à jamais, sauf pour de courtes périodes de révolte, son indépendance politique mais affirmait, dans la compression exaltée de l’exil, la spécificité d’une religion que ses anciens prophètes avaient déjà tirée hors de son statut national étroit et à laquelle il finissait ainsi de donner son double caractère d’universalité et d’intégrisme. Ce VIe siècle fut, dans le monde entier, un moment crucial puisqu’il fut aussi de Zoroastre, du Bouddha, de Confucius, de Lao-Tseu et introduisit ainsi à une histoire ’’planétaire’’ encore plus intégrante dont je n’ai pas à traiter ici et dont d’ailleurs, à ma connaissance, personne n’a encore ’’structuré’’ le cours. Quant à la conception invisible de l’Occident proprement dit, on peut dire qu’elle résulte de la conjonction des facteurs actif-passif du germe grec, considéré comme mâle, et des facteurs inverses passif-actif du germe juif, considéré comme femelle, cette inversion jouant d’ailleurs dans les domaines les plus divers et se manifestant dan une longue série de correspondances où les oppositions (et les complémentarités) s’appellent et se conjoignent point par point. Au polythéisme grec s’oppose le monothéisme juif ; à la philosophie et à la science grecques, la religion et la gnose juives ; aux lois de la nature telle que les Grecs la conçoivent, la Loi dictée par Dieu. Les Grecs entretiennent le sentiment profond de l’harmonie universelle et de la soumission à la nécessité cosmique, ils ont avant tout le sens de l’immanence ; les Juifs exaltent les valeurs individuelles de pureté et de justice, ils ont avant tout le sens de la transcendance. Dans ses aspects perpétuellement contrastés, toute l’histoire de l’Occident ne cessera pas d’osciller entre ces pôles, et tout son dynamisme procède de cette confrontation interne. Cependant, dès le début de cette conception, les grandes lignes du destin des Juifs sont tracées. Soumise tour à tour aux Perses, aux Séleucides, aux Egyptiens, aux Grecs et aux Romains, leur communauté fonde sa puissante autonomie sur un ensemble de facteurs religieux et culturels qui échappent aux prises de n’importe quel pouvoir matériel. Evénement capital de la gnose juive, les caractères de l’écriture hébraïque se fixent dans les vingt-deux lettres de l’hébreu carré. Et c’est peu de temps après la fin de la captivité, lors du retour en Palestine, qu’est rétablie par Esdras l’interdiction des mariages mixtes et que les femmes étrangères sont renvoyées. Ici encore une contradiction est à l’œuvre. Alors que la période de l’exil avait entraîné, au contact d’autres populations, l’effacement de l’identité proprement physique des Juifs, l’endogamie allait au contraire, comme il est de règle, l’accentuation de certains traits non seulement physiques mais caractériels et contribuer à donner corps au faux concept d’une ’’race’’ juive. Mais si l’on peut dire qu’à ces divers titres la période de l’exil fut pour les Juifs, comme le VIe siècle des Grecs, puissamment initiatique, l’essentiel est de reconnaître qu’il s’agit, dans le cas des Juifs, d’une initiation gnostique souterraine, dont le ’’miracle grec’’, dans son épanouissement naturaliste, paraît n’avoir reçu aucune empreinte (et cela malgré l’apparition en Grèce, toujours au VIe siècle, des cultes orphiques sous la probable influence de l’Orient). L’immense majorité des historiens, juifs ou non, sont loin de pressentir et à plus forte raison de dégager l’extraordinaire portée du sacrement reçu à Babylone par la mystérieuse prêtrise issue de Melchisédech et qui fit du peuple juif, dans notre cycle, le peuple vraiment élu par les puissances invisibles pour la réception, la conservation et la transmission de la ’’connaissance’’ par opposition à la ’’science’’. Attachés à une critique purement externe des textes, la plupart des historiens modernes, même juifs, se bornent à constater l’apparition relativement récente des deux ouvrages fondamentaux de la Kabbale, c’est-à-dire de la ’’Tradition’’, le Sepher Yetzirah (ou Livre de la Formation) et le Sepher ha-Zohar (ou Livre de la Splendeur) respectivement entre le IIIe et le VIe siècle de notre ère pour le premier, au XIIIe siècle pour le second, sans s’interroger spécialement sur la longue tradition orale de ces enseignements dont il est dit qu’ils viennent de l’origine des temps. Même si nous sommes toujours réduits aux hypothèses en ce qui concerne le mode de révélation et de transmission de cette connaissance ’’originelle’’, son existence, aujourd’hui, ne paraît plus pouvoir être contestée. L’ancienne image évolutionniste de l’homme des cavernes sortant progressivement de l’animalité tombe en ruine. De plus en plus s’accrédite la thèse que la période néolithique fut entrecoupée de brusques mutations que rien n’annonçait et que marquent l’invention de l’agriculture et la construction des cités — la ville de Catal Hüyük, en Anatolie, remonte au VIIIe millénaire avant notre ère et on y cultivait à cette époque au moins quatorze sortes de céréales — puis la brusque apparition de la science astronomique et de l’astrologie, avec notamment l’invention du calendrier, le tout comme si des ’’instructeurs’’ très évolués étaient venus soudain apporter leur connaissances aux hominiens incultes qui peuplaient alors la Terre et même faire souche avec eux. La tradition indienne nomme ces instructeurs les grands Rishis ; l’Adam de la Genèse était sans doute l’un d’eux, et Caïn son fils fut alors le premier constructeur de villes. Ensuite « ces fils de dieux », dit la Bible, ’’épousèrent les filles des hommes’’, mais malgré ce métissage une ségrégation subsista, et dans son long apprentissage de la raison, la grande majorité des descendants ne perçut de cette science qu’un écho affaibli. Les mythes et les symboles en procèdent : certains documents peu lisibles aussi, comme le Zodiaque et les hiéroglyphes, ou le Yi-King des anciens Chinois qu’on attribue à Fo-Hi, l’empereur mythique. Le cinquième millénaire avant notre ère fut sans doute l’une de ces périodes de mutation et la grande civilisation égyptienne y prit naissance, bien antérieurement à l’époque des Pharaons qui n’en garda qu’une mémoire déjà trouble. Que Pythagore pour les Grecs, Moïse pour les Juifs, soient issus de ce même tronc égyptien, la possibilité en est aujourd’hui admise. Des ouvrages comme le Sepher Yetzirah et le Zohar en seraient alors plus ou moins issus, mais aucune preuve archéologique ou historique n’a pu jusqu’à nos jours en être fournie. Faut-il le regretter ? Il est désormais devenu tout à fait clair pour moi que la reconnaissance de l’ancienneté et de l’importance de ces textes obscurs est beaucoup moins liée à ces preuves ’’externes’’ qu’à la possibilité de l’interprétation de ces textes eux-mêmes, ou plutôt de leur ’’désoccultation’’, c’est-à-dire d’une mise au jour faisant apparaître leur caractère cryptographique plus ou moins fortement concerté. Qu’ils soient incapables de procéder à ce déchiffrement ou qu’aveuglément ils le refusent, c’est de toute façon parce qu’ils en méconnaissent la portée que les historiens modernes se privent d’une juste compréhension métaphysique et métapolitique de la ’’question juive’’, tout entière commandée par la charge de ce dépôt.
La Kabbale se présente en effet sous trois aspects complémentaires. Il existe une Kabbale phonétique, basée sur la magie des sons, une Kabbale graphique basée sur la magie des formes et une Kabbale numérale basée sur la magie des nombres. Je m’en suis tenu pour ma part à cette dernière, qui paraît la plus directement explicitable, mais il est très possible que les expériences assez stupéfiantes poursuivies depuis peu par certains physiciens avancés sur ce qu’ils appellent les radiations ou les émissions de formes viennent encore plus vite, s’ils peuvent en donner la formule mathématique, bouleverser l’ensemble de nos sciences. »
« Lorsque Leibniz, à la fin du XVIIe siècle, reçut des jésuites rentrant de Chine les premières données parvenant en Occident sur le Yi-King (le livre chinois dit des transformations issu au moins du troisième ou du quatrième millénaire avant notre ère), il eut de même la puissante intuition que l’idéogramme complexe proposé par ce livre représentait, dans l’ensemble tournant de ses 64 hexagrammes, la ’’caractéristique universelle’’ que depuis longtemps il cherchait, c’est-à-dire le moule où s’informait toute vision globaliste des lois du monde. Depuis la découverte du code génétique et de ses 64 codons, dont la structure particulière reproduit exactement celle des 64 hexagrammes chinois, les ésotéristes contemporains ont de fortes raisons de penser que l’intuition de Leibniz était fondée, mais il me paraît également de plus en plus clair que la dialectique ’’sphérique’’ de la double contradiction, telle qu’elle résulte du fonctionnement de la SA (Structure Absolue), s’identifie dans le moindre détail à celle du Yi-King, et que, dans ces conditions, l’Arbre des Séphiroth, qui est l’idéogramme fondamental de la Kabbale, doit être considéré, du fait de la répartition elle-même sphérique des 22 lettres hébraïques, comme un document aussi fondamental pour notre cycle que le fut, pour la civilisation chinoise, depuis six mille ans, la roue des 64 hexagrammes. C’est cette même dialectique sphérique que j’ai proposé d’appeler ’’logique de la double contradiction croisée’’, qui constitue au sens le plus strict ce qu’on désigne ici sous le vocable de gnose, et il faut donc avant tout considérer celle-ci comme une méthode de pensée et éviter de la confondre avec les ensembles doctrinaux, théogoniques ou cosmogoniques, qui n’en furent au cours des siècles, sous cette même appellation et notamment au début de l’ère chrétienne, que des émergences affaiblies et insuffisamment formalisées. En détruisant toute conception linéaire d’’’avant’’ et d’’’après, d’’’au-delà’’ et d’’’en deçà’’, d’’’origine’’ et de ’’fin’’, une dialectique réellement sphérique rend naïves, relativise et même jette à bas toutes les notions utilitaires de hiérarchie et d’autorité, ce qui explique que les doctrines gnostiques, plus ou moins directement inspirées, du fait de leur ’’dualisme’’, au cours de l’histoire, par cette dialectique, aient toujours été considérées comme asociales et anarchisantes par les pouvoirs politiques, mais également comme hérétiques ou apocryphes par les religions exotériques exclusivement attachées à l’expression dogmatique, mystique ou morale de la foi. Aussi bien la connaissance et le maniement de la dialectique gnostique introduisent-ils à ce type d’illumination et de présence à l’être que Mircea Eliade, pour le différencier de l’extase proprement mystique, propose de désigner sous le nom d’enstase, mais qui, par les voies intellectuelles de la conscience transcendantale, n’en aboutit pas moins à la vision vécue de l’interdépendance universelle et à la conscience intime de la fusion ou de la communion en Dieu.
Reste qu’au cours des premiers siècles qui suivirent le retour de l’exil babylonien, la Kabbale, occultée et enfouie dans le secret de l’enseignement rabbinique, n’apparaît pas dans l’action théocratique de la caste sacerdotale qui dirige le peuple juif. Toute religion socialisée tend à s’enfermer dans sa lettre, ses préceptes moraux de cohésion sociale et ses rites de moins en moins compris, et la religion juive plus que toute autre, puisque Israël privé de son indépendance politique, ne préservait son caractère particulier que par elle. Il était alors normal que la croyance en un Messie qui viendrait délivrer le peuple juif et le rétablir dans toute sa force matérielle accentuât l’aspect exotérique d’une religion dès lors toute encombrée des querelles entre ses modernistes et ses intégristes. Sadducéens et pharisiens se disputaient ainsi le pouvoir religieux tandis que dans l’ombre, indifférente aux jeux sociaux, la secte des esséniens maintenait la tradition gnostique. La brusque apparition de Jésus fut celle d’un Essénien excédé par les querelles et la corruption du Temple. Dans cette deuxième époque charnière de la généalogie de l’Occident, les paroles fondamentales de Jésus, qui ne pouvaient que faire scandale, s’adressèrent en premier lieu au peuple qui attendait un Messie terrestre : ’’Mon royaume n’est pas de ce monde’’, et ensuite aux prêtres et aux scribes : ’’Vous avez égaré les clefs de la connaissance’’. En le livrant à la puissance romaine, les docteurs juifs s’abandonnèrent alors à un acte impie qui témoignait du franchissement, par leur peuple, de ce seuil historique au-delà duquel l’incarnation de l’esprit dans la matière, si transfigurante qu’elle soit pour le gnostique, n’est plus ressentie que comme un emprisonnement, une punition, un incompréhensible décret de la puissance de Dieu. Au début de l’ère chrétienne, le peuple juif, tel qu’il est issu du mystère du Golgotha, cesse d’appartenir, en tant que peuple, à l’histoire visible, et change ainsi symboliquement de sens. Dès que s’affirme le succès du christianisme, toute une série de faits nouveaux vont survenir dont le plus important, quant à l’objet de notre étude, est entre le IIIe et le VIe siècle, une première divulgation de la Kabbale par la présentation écrite du Sepher Yetzirah. Mais avant d’examiner, quant à l’inversion de l’hébraïsme, la signification de ce fait, il faut se demander en quoi la nouvelle religion, pourtant créée [plutôt inspirée] par un Juif, apporte une fondamentale nouveauté. En tant que porteur de l’idée de Dieu, le Fils en effet se substitue brusquement au Père et le culte de la paternité laisse la place à une religion de la fraternité. A ces hommes que la loi mosaïque courbait sur leur tâche d’hommes, Jésus vient dire : la liberté de Dieu est aussi votre liberté, le Fils de l’homme est aussi le fils de Dieu, et tous, semblables à moi, vous deviendrez Dieu. Le fondateur de l’anthroposophie, Rudolf Steiner, un des plus importants ’’prophètes’’ du XXe siècle, voit avec raison dans la naissance de Jésus l’irruption, en Occident, de la conscience de la liberté. La religion hébraïque maintenait ouverte la transcendance de Dieu, Jésus vient en quelque sorte combler et fermer cette transcendance : dès lors Dieu et l’homme ne sont plus dans un rapport de maître à esclave ou d’autorité à soumission mais, comme le père et le fils, dans un face à face de confrontation et d’affrontement, puisque la visée du Fils est de devenir Père à son tour. On se trompe du tout au tout en faisant du christianisme, dans son ensemble, une religion d’esclaves. Selon Jean Largeault, » le sens du message du Christ est prométhéen. Le christianisme généralisera la tragédie. […] La situation tragique, c’est en effet d’être à la fois le père et le fils « . C’est ici le nœud. Et le nom même donné à Jésus, qui devient Jésus-Christ, conjoignant ainsi deux appellations, l’une hébraïque et l’autre grecque, signifie déjà non seulement la naissance d’une nouvelle religion mais celle d’un nouvel Occident [alliant l’héritage grec et l’héritage hébraïque]. Accomplissant et abolissant la Thora au nom de la liberté intérieure de l’homme, le Christ épouse également, transfigure mais mine aussi de l’intérieur l’utilitarisme et l’efficacité du génie grec assimilé dès son époque par le génie romain. Il est d’ailleurs significatif que ce ne soit pas l’Essénien Jésus qui fonde le christianisme en tant que religion de masse socialement cohérente et hiérarchisée, mais un juif romanisé formé par les pharisiens et qui devint saint Paul. Et le coup de génie de ce dernier, alors que la religion juive, même au sein de la diaspora, restait la religion d’un peuple, fut de confier l’expansion du christianisme non plus à un peuple mais à une Eglise et de prêcher ainsi le Christ indifféremment à toutes les nations. Tandis que les valeurs universalistes socialement subversive, portées par le peuple juif recèlent d’abord la contradiction d’être celles d’un peuple particulier fermé sur soi et s’offrant ainsi aux coups des autres peuples, les valeurs non universalistes et à l’origine non moins subversives du christianisme voient très tôt l’Eglise qui les porte et qui peut se dire exclusivement spirituelle s’allier aux pouvoirs établis de tous les peuples et se plier, en ne recevant d’eux qu’une conversion formelle, aux disciplines sociales les plus contraignantes. En 313, par l’édit de Milan, Constantin transforme l’Empire romain en empire chrétien et aussitôt apparaît un phénomène tout à fait nouveau, l’antisémitisme. Toute société humaine tend à refuser ou à dénaturer les valeurs universelles qui, dans leur essence même, contredisent les valeurs particulières de son originalité et de sa force. L’Eglise romaine peut passer à ce sujet des compromis sans cesser d’être une Eglise, le peuple juif en tant que peuple ne le peut pas sans cesser d’être un peuple. On ne peut alors qu’admirer l’adéquation supérieure qui fait servir la dispersion d’Israël à sa vocation et à sa survie. Sous l’accusation commode de déicide, le Juif isolé peut être persécuté, les petites communautés juives peuvent être détruites, Israël subsiste. Sa dispersion le protège. Elle lui permet aussi d’étendre, de répander partout cette action immobile de présence qui, au regard de ses valeurs idéales, fait sans faute apparaître la contradiction des autres valeurs. Le peuple juif devient ainsi l’intelligence du monde tout en éveillant sa mauvaise conscience. Mais corrélativement, ses docteurs commencent à livrer au grand jour l’enveloppe de mystique et de magie de la Kabbale. Et certes, ils ne le font pas sans le sentiment intime d’une puissante fatalité : ’’Rabbi Siméon se mit à pleurer et dit : Malheur à moi si je révèle ces mystères et malheur à moi si je ne les révèle pas !’’ Que signifie, entre le IIIe et le VIe siècle, cette apparition du Sepher Yetzirah ? Jetée sur le papier, cette parole qui était vivante est comme une lumière qui s’éteint. A s’en tenir à sa lettre, en l’absence de clefs appropriées, ce texte est incompréhensible. Comme toute phénoménologie réellement transcendantale, la dialectique sphérique qu’appelle la Kabbale est d’ailleurs ce qui, au monde, est le moins communicable par le discours écrit. A quoi tend alors cette divulgation incomplète, cette profanation ? Un secret ne se dévoile à demi que pour deux raisons, par provocation ou par inadvertance. La provocation s’adresserait ici aux simples ’’croyants’’, pour leur montrer par ce texte tout ce qui oppose l’universalité inconditionnée de la connaissance à l’image socialisée qu’ils se font d’un Dieu non seulement créateur mais législateur et intervenant dans les affaires du monde sous le couvert des prêtres et des rois. Mais on peut aussi mettre en cause l’ignorance, l’incompréhension relative des détenteurs de l’ancienne gnose. Ces clefs que les scribes et les pharisiens avaient égarées, les descendants des Esséniens ne les auraient-ils pas perdues à leur tour ? Cette divulgation incomplète sert la mystique, pas la gnose. Il y a, entre la gnose et la mystique, le même rapport qu’entre l’intensité et l’ampleur. Ce que la première perd en compréhension, la seconde le gagne en extension. Faut-il penser que le peuple juif, dès la crucifixion de Jésus, est entré dans un processus d’involution ? Il n’y a dans cette proposition aucun jugement de valeur péjoratif, qui serait au surplus interdit par la dialectique. Tout ce qui au monde apparaît régressif s’accompagne d’une progression cachée, et réciproquement. Il n’y a pas d’involution sans évolution simultanée, et aucune perte d’intensité ne saurait donc être considérée comme absolue : il faut qu’elle soit considérée sur un autre plan par le jeu d’une autre intensité, ce qui signifie qu’il faut alors déterminer le nouveau champ où les premiers effets de la prétendue régression deviennent au contraire positifs. Que l’involution juive, au Moyen Âge, soit cependant de plus en plus manifeste, la divulgation, au XIIIe siècle, du second livre de la Kabbale, le Sepher ha Zohar, en témoigne avec éclat. Ici le passage de la gnose à la mystique est encore plus net que dans la divulgation du Sepher Yetzirah. Ce dernier livre ne comporte qu’un texte très court, très abstrait, d’une extrême densité, en une douzaine de pages. Au contraire, le Zohar qui abonde en allégories, en descriptions imagées, se trouve être d’une trompeuse facilité de lecture tout en s’étendant sur des milliers de pages : il illustre par là même les progrès considérables de l’ampleur. Quant à savoir où et comment les Juifs compensent cette ’’dégradation’’, on notera seulement qu’après avoir été essentiellement, dans l’Antiquité, un peuple d’agriculteurs et de guerriers, ils se trouvaient au Moyen Âge exclus de la possession du sol et réduits aux fonctions commerciales alors décriées, en sorte qu’ils ne tardèrent pas à monopoliser les transactions bancaires. Ce qu’ils perdaient au niveau de la connaissance, ils le compensaient à celui de la puissance, ce qui manqua d’ailleurs pas d’entraîner de nouvelles persécutions dès qu’une classe marchande rivale, après les Croisades, commença à se former en Occident. Cette réussite financière qui allait fonder, quelques siècles plus tard, leur puissance mondiale, mettait en jeu des valeurs non moins universalistes que celles des principes iavhiques de justice et de pureté. Et qu’est-ce que l’argent en effet, sinon, au plan matériel, et universellement admis, le signe de la valeur en soi, la mesure commune de toutes les valeurs ? Mais le prêt à intérêt et l’usure, condamnés par le christianisme et pratiqués par les Juifs, ne font rien d’autre que marquer le caractère purement accumulatif, répétitif, de cette valeur, c’est-à-dire son caractère d’ampleur pure, au point le plus bas de la dégradation de toute valeur. Et telle est bien en effet la signification ésotérique de la monnaie, symbolisée par la matière la plus dense et en quelque sorte la plus matérielle, celle des métaux. Cette intensité invertie est celle de l’hémisphère d’en bas de la ’’structure absolue’’. Elle ne joue plus au plan de l’esprit. L’intensification se marquera d’ailleurs de plus en plus nettement dès que commencera, à la Renaissance, la période ’’baptismale’’ et réellement prométhéenne de l’Occident, à une époque qui se présente aussi comme une charnière pour le destin des Juifs, car l’affrontement du Père iahvique et du Fils christique y devient patent dans la mesure même où, par son ’’baptême’’, le Fils accède à l’autonomie de son ’’âge de raison’’ et prend à son tour stature d’Epoux conquérant, ce qui ne peut avoir pour effet que d’affaiblir et de décolorer l’image qu’un nombre croissant de Juifs ’’modernisés’’ vont dès lors se faire de Iahvé ainsi repoussé au rang de Grand-Père et réduit à n’être qu’une survivance sans force, un patriarche plus ou moins ergotant ou abusif à l’égard duquel toute soumission devient névrotique. Bien plutôt qu’à la date de 1453, où Constantinople est prise par les Turcs, ce qui fixe définitivement les frontières orientales de l’Europe, les Temps modernes commencent à l’année 1492 qui voit le succès des grandes migrations océaniques et le grand déplacement vers l’Ouest des frontières de l’Occident. Mais, par une coïncidence pleine de sens, alors que Christophe Colomb s’embarque à Cadix, cette même date est aussi celle de l’expulsion ds Juifs d’Espagne qui fut ressentie par le peuple d’Israël tout entier comme une immense catastrophe, le début d’une nouvelle ère de tribulations et de malheurs. La même mesure fut d’ailleurs immédiatement prise en France en 1494 et au Portugal en 1496. Il n’est pas indifférent de constater que l’émergence du Zohar, moins de deux siècles plus tôt, avait également eu lieu en Espagne, de sorte que les trois éléments de la grande divulgation, de la grande expulsion et de l’expansion soudaine de l’Occident vers l’Amérique apparaissent étrangement liés, et cela au cœur même de l’Occident ancien qui se veut le centre du monde.
Quant au déroulement de l’histoire invisible, cette triple rencontre dans le temps et dans l’espace est l’une des plus fascinantes que je connaisse. Et c’est en effet sans que les Juifs expulsés s’en rendissent compte que s’ouvrait en même temps à l’extrême-ouest ce qui allait devenir, en Amérique, leur nouvelle base d’action, et en quelque sorte, à New York, la Jérusalem invertie de leur nouvel établissement, mais c’était plutôt une nouvelle Babylone, et cette fois le temple de l’or [de la puissance financière] et non plus de la connaissance. Dans son livre sur Les Grands Courants de la Mystique juive, le Pr. Gershom Scholem souligne avec force que le kabbalisme subit, après l’exode d’Espagne, une complète transformation : ce corpus ésotérique passe à l’état de doctrine populaire. Dès le début du XVIe siècle, les écrits juifs sont animés par le sentiment profond de la signification religieuse des catastrophes, et l’on insiste sur le caractère rédempteur de l’Expulsion. Les éélments messianiques de la doctrine passent alors au premier plan, et la vie mystique et ascétique traditionnelle des kabbalistes, qui est comme un retour à l’état parfait de l’ « origine du monde », se combine avec la vision et le désir apocalyptique de sa « fin », en sorte, écrit Scholem, que tout retourne ainsi à l’unité et à la pureté du « commencement ». Je ne m’étendrai pas ici sur les thèses religieuses ou métaphysiques de cette nouvelle Kabbale, dont Isaac Luria et Cordovero furent les penseurs les plus éminents, ni sur leurs prolongements, au XVIIe siècle, dans l’ « hérésie » sabbatianiste, qui développa les idées anarchistes et même nihilistes implicitement contenues dans la Kabbale de Luria. Je noterai seulement qu’à se moment, chez les docteurs juifs, triomphe l’étrange thèse du Tsim-Tsum selon laquelle Dieu ne crée le monde et ne ménage la liberté des hommes qu’en se mettant lui-même en état d’exil, de limitation, de retrait, ce qui, cette fois, invertit jusqu’à l’omnipotence de Dieu mais sublime aussi, en les inscrivant dans le Ciel, les difficultés terrestres du peuple juif. Ce fut certes toujours un problème métaphysique grave que de concilier l’omnipotence de Dieu et la liberté des créatures, mais il faut bien dire aussi que ce problème n’est insoluble que si l’on s’attache à trouver la liberté des hommes là où elle n’est pas, c’est-à-dire au niveau des corps et des âmes, où l’on fait alors jouer un « libre arbitre » naïf et tout subjectif, une capacité de choix qui ne se croit autonome que parce qu’elle ne sait pas se fondre dans le tissu sans couture de l’interdépendance universelle. De même, selon Spinoza, que la paix n’est pas l’absence de guerre mais une vertu de l’âme, la liberté de l’homme n’est pas dans son pouvoir d’agir sur des événements extérieurs considérés eux-mêmes comme indépendants, mais de les relativiser par l’esprit et en fin de compte de les fondre et de les effacer dans l’événement unique et universel qu’est à tout moment l’assomption de l’être absolu, et c’est alors la liberté de l’homme intérieur immobile vivant dans l’intime participation à la présence de Dieu. Toutes les sectes gnostiques dites dualistes apparues au cours des temps, notamment aux premiers siècles de l’ère chrétienne, n’ont émergé dans l’histoire visible que parce qu’elles procédaient à une telle dégradation « physique » de la liberté des créatures, et cette émergence prématurée marquait alors la dégradation de la gnose elle-même. Les thèses manichéennes sur le dithéisme, c’est-à-dire la coexistence d’un Dieu du Bien et du Dieu du Mal, ne furent qu’un artifice scolastique pour faire passer la liberté et la justice du plan métaphysique au plan moral et ériger ainsi en préceptes réglés les attitudes les plus diverses et mêmes les plus opposées sur la répression ascétique des corps ou leur total dévergondage. Il s’agissait là, en fin de compte, de manifestations non plus gnostiques mais mystiques ou même magiques. L’exemple historique le plus enseignant à cet égard est fourni par l’ « hérésie » cathare qui, en France, aux XIIe et XIIIe siècles, submergea le Languedoc et le conduisit à sa fin. Ici encore, la doctrine gnostique des « parfaits », dès qu’elle s’extériorisa et toucha le peuple, se dégrada, qu’elle le voulût ou non, en nihilisme social, sans qu’on pût dire ici non plus si la persécution extérieure était la cause ou l’effet des déformations mondaines de la doctrine. Un épouvantable génocide s’ensuivit qui a marqué l’Occitanie pour des siècles. Je suis persuadé que le récent génocide des Juifs s’inscrit en profondeur dans une corrélation analogue. Au XIIIe siècle, dans un Languedoc libéral, voué aux arts et raffiné comme on l’est au cœur des décadences, l’Eglise romaine joua le même rôle qu’au XXe siècle, en Occident, le mouvement nazi. Dans les deux cas, le parti de l’ordre prétendit rétablir les valeurs de hiérarchie, d’austérité, de cohésion sociale qu’on déclarait menacées de subversion par la dégradation spirituelle d’une civilisation que son avancement même, sa facilité et son goût du luxe vouaient à la dissémination, aux complications intellectuelles, au relâchement moral. Et assurément, dans le cas de l’Occitanie comme dans celui du peuple juif, une gnose était en jeu, dont l’émergence mondaine, tout à fait contraire à sa nature [erreur : elle était vouée à la divulgation, en accord avec le projet chrétien de rendre les mystères accessibles et compréhensibles à tout le monde et de faire accéder tout le monde à une connaissance naguère réservée à une élite restreinte, et chaque divulgation a entraîné un sacrifice de masse pour permettre aux masses futures de bénéficier des conséquences positives de chaque divulgation], fournissait au peuple languedocien et à ses chefs les alibis de ce modernisme intempérant. En prêchant publiquement la fondamentale impureté d’une Création que rien, selon eux, ne pouvait racheter, les ascètes cathares permettaient à la noblesse et au peuple du Languedoc de penser, puisque Dieu était absent de ce monde, que tout y était permis. Et depuis le grand Exil, il en a été de même, toujours en profondeur, du peuple juif et de ses chefs apparents, les maîtres de la finance internationale, lorsqu’ils se sont armés, contre un monde qui les rejetait, d’un réalisme sans pitié et d’une volonté de possession qui ne connaissait pas de limite. Qu’on m’entende bien : il me faut répéter ici sans me lasser que je ne cherche pas des « causes » au sens banal du mot. Et une fois encore, il s’agit moins de dégager des « responsabilités » linéaires que des « correspondances » [transversales]. Seules ces dernières permettent de comprendre ce qu’il faut appeler le projet de l’histoire invisible, au sens que j’ai donné à ces mots. Dans le cas de l’Occitanie comme du peuple juif, ces correspondances, c’est un fait, jouent au niveau d’une gnose dont l’émergence catastrophique dit assez la dégradation. [C’est l’inverse : l’émergence mondaine implique nécessairement le dévergondage, à cause de l’écart entre le fonds ésotérique et l’apparence profane, la hauteur du projet et la bassesse des conditions, faisant que le monde réel n’a d’autre choix que d’essayer de s’approprier l’idéal ésotérique pour l’appliquer à son profit immédiat : d’où l’accusation, non seulement sommaire mais infondée, de Guénon et d’Abellio contre des Occitans anarchisants et arrogants, qui ne firent rien d’autre en réalité, et ils eurent évidemment raison, que d’assumer l’héritage gnostique par ailleurs trahi par l’église romaine soi-disant chrétienne, et tandis que les scribes et les pharisiens avaient égaré les clefs de la connaissance (après avoir voulu se les accaparer en totale exclusivité), les Wisigoths d’Occitanie et de Catalogne ont mis ces clefs en œuvre (ce que Guénon désignait comme des « données ésotériques incomprises » au sein du catharisme), en accord avec le ministère de Jésus-Christ et l’enseignement christique ; j’ai tordu le cou à cette critique guénonienne dans Les Cathares 700 ans plus tard.] Rien de plus futile d’ailleurs que de se demander si cette profanation mondaine pouvait être évitée, puisqu’elle fut chaque fois en rapport avec la pression souterraine de l’incarnation de l’esprit, invisible moteur, en tout temps, des fatalités de l’histoire mais aussi et en même temps de la genèse de la conscience. Toute la durée des Temps modernes est marquée par la continuité plus ou moins apparente de cette pression [qui atteint désormais son paroxysme diluvien apocalyptique et ultime]. Dans le premier tome de ces Mémoires, j’ai noté par exemple, pour la France, les autres correspondances qu’il faut établir (et où les historiens profanes voient une filiation) entre le catharisme albigeois et le calvinisme cévenol, puis le laïcisme et le socialisme occitans, nouvelles religions de masses elles aussi porteuses de valeurs abstraites tendant à la fois à la subversion et à l’absolutisme social, mais il faut aussi se demander si, de son côté, en se mettant à dénoncer la société capitaliste et à s’ouvrir au messianisme marxiste et à la révolution dite sociale, ce n’est pas l’Eglise chrétienne tout entière qui devient à son tour manichéenne et témoigne ainsi, par un ultime prolongement entropique, de l’intensification paroxystique de ce procès. Tout se passe en fin de compte comme si le manichéisme des premiers siècles, apparemment extirpé par l’ordre catholique romain, avait si bien contaminé le christianisme que celui-ci, à force de descendre dans le social, y était devenu encore plus ’’révolutionnaire’’ et ’’subversif’’ que tous les catharismes dégénérés qu’il a combattus au cours de son histoire tout en exaspérant chaque fois davantage, pour les abattre, la fatalité de sa propre mondanisation. A la fin du XVIIIe siècle, lorsque commença la crise communielle de l’Occident et que les nouveaux Etats-Unis d’Amérique et la Révolution française, en proclamant les ’’droits de l’homme’’, donnèrent définitivement droit de cité à des valeurs tenues jusque-là comme contraires à l’ordre social, un fait concomitant essentiel, celui de la reconnaissance aux USA comme en France de la citoyenneté pleine et entière des Juifs, fit, pour la première fois, confluer de manière visible la généalogie de l’Occident et le destin des Juifs. Cette généalogie et ce destin vont dès lors s’accomplir ensemble dans une parfaite symbiose, et l’on pourrait même penser que les rapports d’inversion qui les reliaient depuis l’origine se sont trouvés du même coup invertis eux-mêmes et transformés en rapport direct. En réalité, établis au cours des siècles précédents au niveau de l’ampleur (l’exil, la dispersion et l’enrichissement des Juifs accompagnant l’expansion impérialiste de l’Occident) ces rapports vont désormais se nouer au niveau de l’intensité (la concentration agonistique simultanée du pouvoir des Occidentaux et des Juifs opposant, en gros, le capitalisme industriel, sédentaire et nationaliste des uns, et le capitalisme financier, nomade et apatride des autres). Mais l’essentiel consiste en ceci : en donnant la citoyenneté aux Juifs, les Etats ’’libéraux’’ modernes n’ont fait qu’aggraver de façon décisive la contradiction du peuple juif lui-même dans son ensemble, ainsi amené à comprimer les valeurs transcendantes dont il est le porteur au sein de patries qui, par essence, ne peuvent qu’en refuser le libre jeu. Le sachant ou non, le peuple juif, dont la dispersion assurait jusque-là la pérennité et la force, s’est trouvé pris dans ce dynamisme mais aussi cette illusion des systèmes clos qui avait permis l’expansion de l’Occident depuis la Renaissance mais se préparait désormais à le conduire à sa ruine. Et l’on peut même dire que l’octroi de la citoyenneté fut ainsi, pour les Juifs, un cadeau mortel. » Un cadeau mortel pour les Juifs déviés, pervertis par la tendance à la fois puérile et patriarcale à tout prendre au pied de la lettre et à vouloir modeler la réalité selon un modèle spirituel qui ne peut et ne doit s’incarner que par l’éthique individuelle et la connaissance de soi : ainsi s’achève et se consume de nos jours le satanisme talmudo-sioniste dans l’enfer de Gaza.
Cet extrait a été lu lors de cette émission, à partir de 1:06 environ.